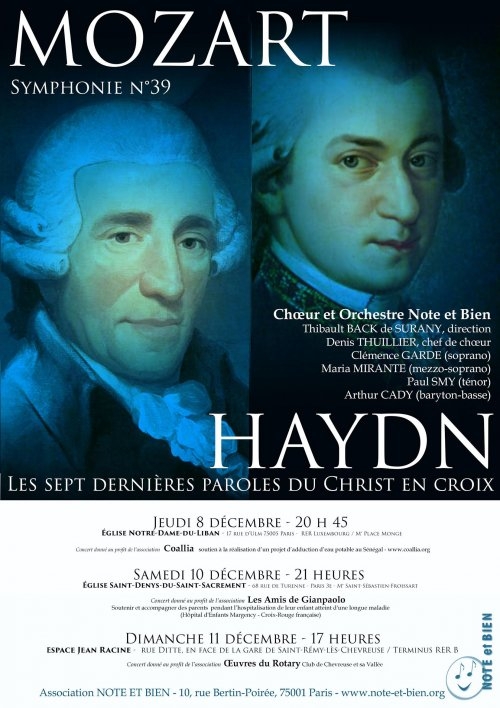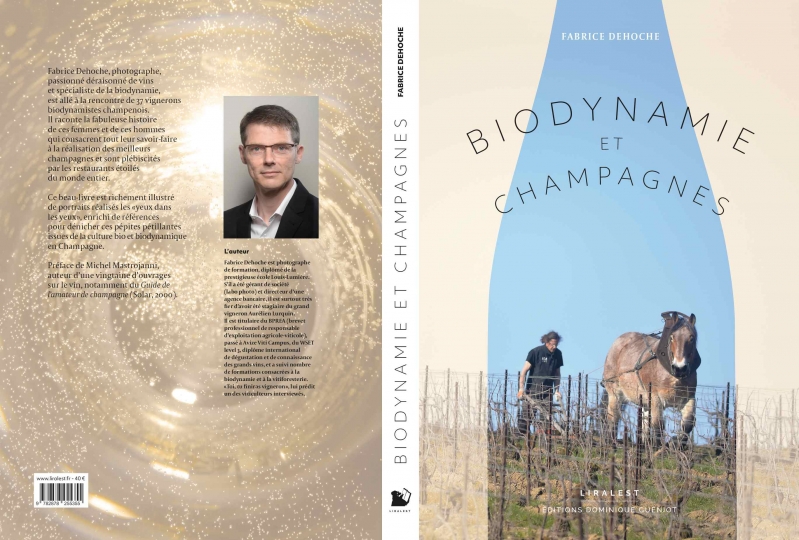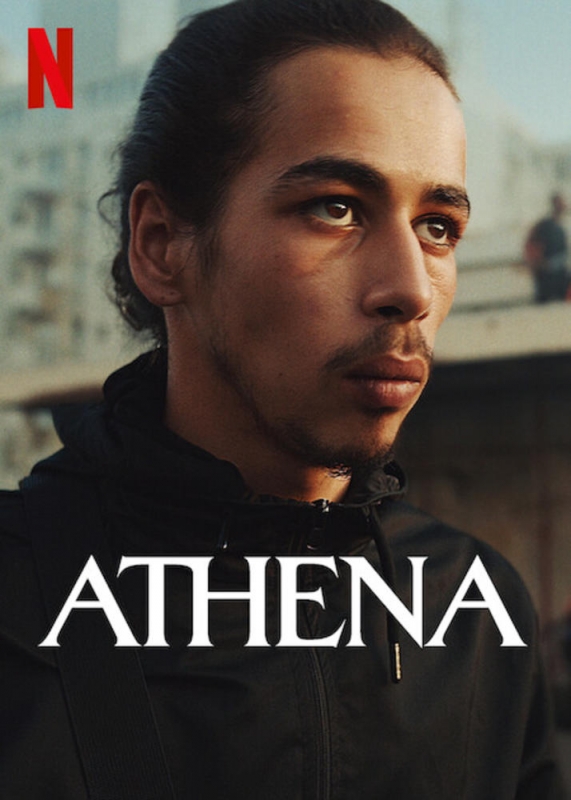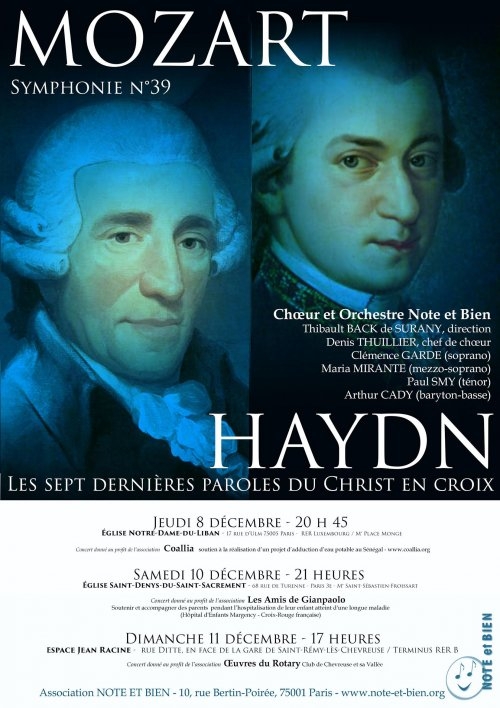
Jean-François Pioud-Bert, promo Ciné 1973, a développé une petite merveille de site autour de l'histoire des caméras: cinecameras.fr
"Qu’est-ce qu’une caméra ?
Est-ce que les Frères Lumière, en 1895, auraient pu imaginer le développement, l’expansion, voire la banalisation de leur invention ?
Car aujourd’hui, les caméras sont partout et tout un chacun a le loisir de « filmer », même avec des appareils hybrides… (smartphone, tablette, etc.). Tout se filme et s’enregistre !
Bref, si l’objet s’est banalisé, la caméra reste une curieuse machine : celle qui permet de faire du cinéma, sous toutes ses formes. Filmer la vie, témoigner de ce qui nous entoure, raconter des histoires… La caméra est bien un œil singulier, même si on a pu parler un moment de stylo…
A l’heure du tout numérique, il est peut-être nécessaire de revenir sur les caméras argentiques, celles qui travaillent avec de la pellicule. Premières caméras mécaniques actionnées par une manivelle, puis mues par l’électricité. Caméras en bois, caméras métalliques, caméras en plastique ; caméras bruyantes, caméras silencieuses… Caméras singulières… Caméras pour professionnels et amateurs…
Cinecameras.fr se propose de dresser un bref inventaire de ces merveilleuses machines qui nous ont fait rêver, qui ont porté le rêve." [texte extrait du site]
--
Pour tout contact ou information, vous pouvez écrire à Jean-François sur l'adresse cinecameras@cinecameras.fr ou via le formulaire contact de son site
Photo d'illustration : L’actrice Allene Ray avec sa caméra Pathé Baby au côté d’un opérateur anonyme et sa caméra Bell Howell 2709 filment la même scène. Photographe inconnu.